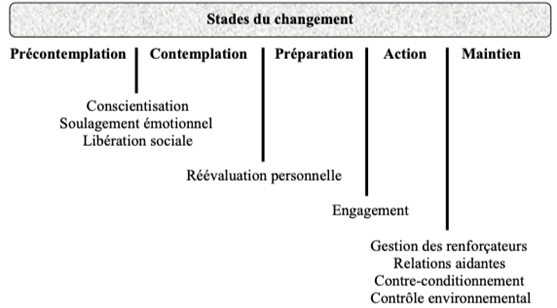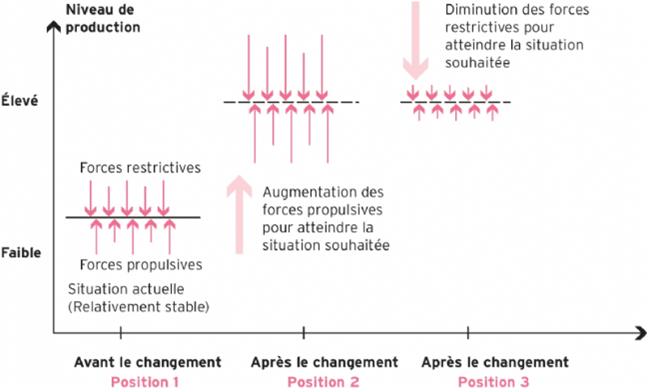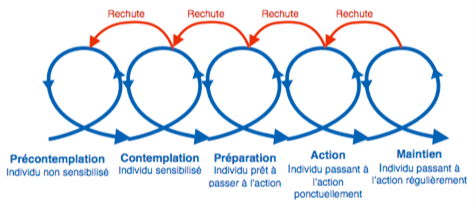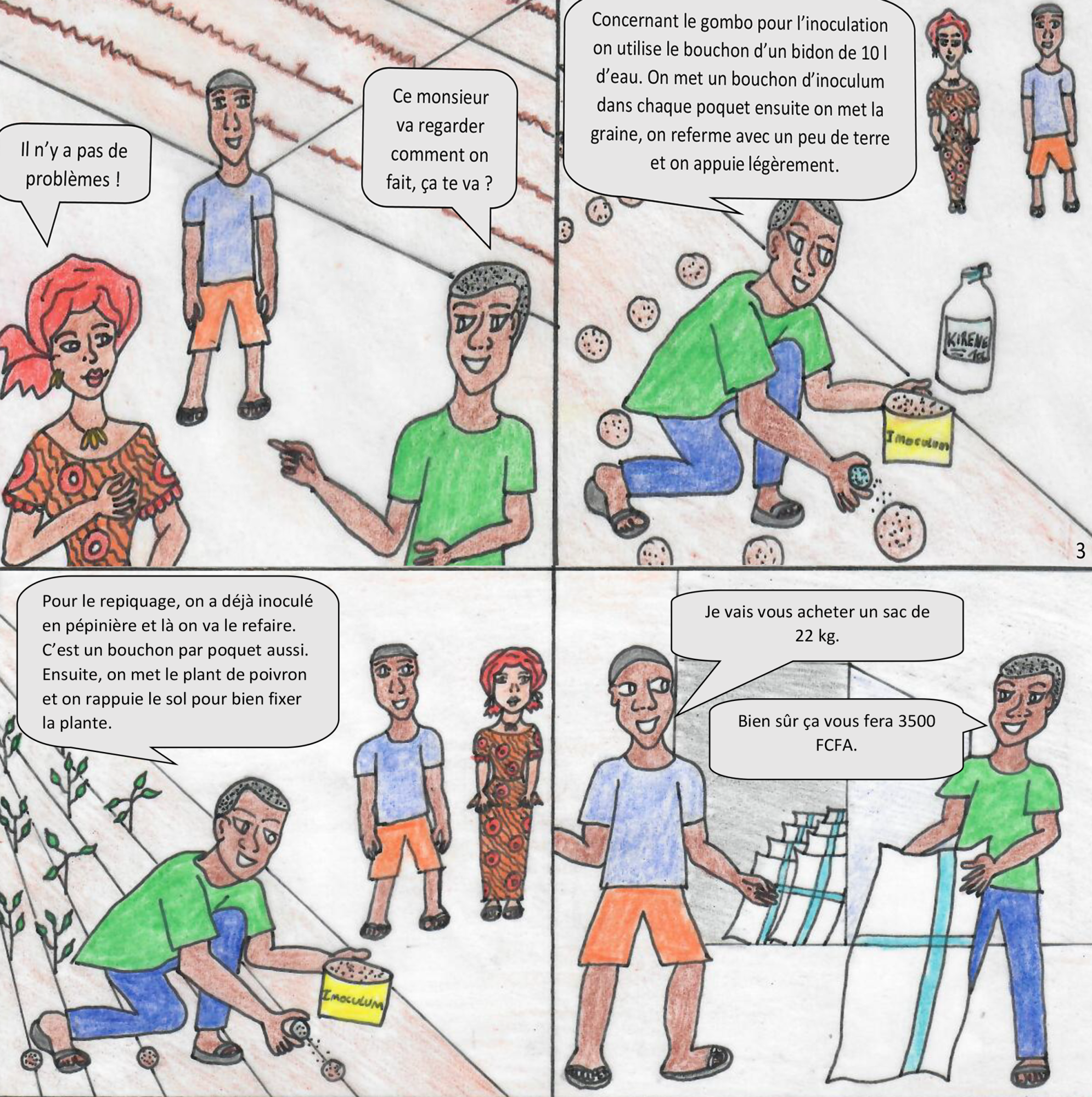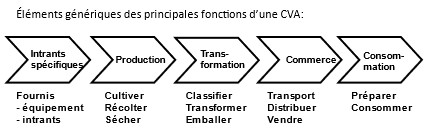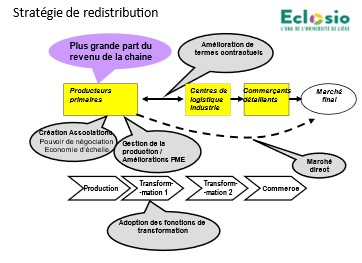Une analyse de Elsa MEERT, diplômée en Anthropologie à l’Université de Liège et actuellement en cours de Master de spécialisation en études de genre proposé par les six universités de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Lire l’analyse en version word
Diverses formes de persécutions et de dominations sont vécues au quotidien, non seulement par les femmes migrantes, mais par les femmes en général. En Belgique et ailleurs, explorons le parcours migratoire de ces femmes, à la loupe de l’anthropologie.
Persistance de l’invisibilisation des femmes migrantes dans l’imaginaire lié aux migrations
Depuis le début de l’humanité, les individus, hommes et femmes, se sont toujours déplacés. Pourtant, il existe un vide théorique concernant les femmes dans les recherches sur la migration (Oso Casas, 2004). Durant les années 80, une ouverture conceptuelle à l’étude de la migration féminine se produit, alors que ce type de migration n’était pas un phénomène nouveau. En effet, comme le confirme Morokvasic (2011), politologue incontournable dans le domaine d’études sur la migration, les femmes ont toujours été présentes dans les mouvements migratoires. Grâce à une approche globale, sur un laps de temps long, Linda Guerry et Françoise Thébaud (2020), historiennes, ont pu démontrer la variation considérable au cours du temps de la répartition sexuée des flux migratoires. Ces derniers dépendent notamment des contraintes et de l’espace géographique.
L’invisibilité des femmes migrantes dans la littérature peut s’expliquer par l’influence patriarcale (Oso Casas, 2004). Celle-ci considère que la femme est dépendante de l’homme, principal support économique et détendeur de l’autorité dans la sphère domestique (Morokvasic, 1986). Les femmes auraient été ignorées dans la majorité des disciplines en raison de leur soi-disant non-implication dans la sphère marchande. Comme elles n’avaient pas d’emploi salarié, cantonnées à rester dans le foyer, elles ne pouvaient pas faire partie de la sphère productive. Cela explique le manque d’intérêt à prendre en considération le point de vue des femmes dans le contexte de la migration. Elles sont longtemps demeurées dans l’ombre, tout comme dans de nombreux autres domaines de recherche.
Finalement, on prendra conscience que l’immigration implique généralement l’installation des familles, et donc de la femme, dans le pays d’accueil. C’est sous l’angle d’épouses regroupées et non d’actrices économiques et sociales que les femmes seront envisagées dans un premier temps (Oso Casas, 2004 ; Asis, 2005). Les migrantes étaient perçues comme des femmes qui suivent leur époux, leur père, ou leur frère, subissant donc les processus migratoires (Dahinden et al., 2007). On souligne ainsi le caractère passif et non actif, de la migration féminine.
Cependant, le regroupement familial n’est pas la seule cause de la migration féminine (Morokvasic, 1986). En effet, il existe d’autres facteurs structurels, tels que la demande de main-d’œuvre en Europe durant les années 70 dans les industries modernes, le service domestique… Travaux peu qualifiés et mal rémunérés (Oso Casas, 2004). De plus, indépendamment des phénomènes de migration, la Seconde Guerre mondiale avait fait quelque peu évoluer les mentalités en ayant permis, en l’absence des hommes partis au combat, de démontrer la capacité des femmes à travailler et à ne plus être cantonnées à leurs tâches domestiques. Progressivement, la figure de la femme en tant qu’actrice économique est de plus en plus admise.
Dans la foulée de ce constat, de nouvelles unités d’analyse émergent. Les recherches examinent les conséquences du processus migratoire, non seulement pour le·la migrant·e mais également pour les membres de la famille, considérant alors la décision de migrer comme le fruit d’une négociation entre plusieurs personnes (Dahinden et al., 2007). Les femmes entrent donc en ligne de compte comme co-décideuses, réceptrices d’envois de fonds ou comme des migrantes et donc initiatrices des transferts d’argent. Il y a également une prise de conscience que les processus migratoires n’affectent pas de la même façon les hommes et les femmes. Le genre commence donc à être pris en compte dans l’analyse des mouvements de population (Timmerman et al., 2018). Alors que les premiers travaux avaient pour objectif principal de sortir les femmes migrantes de l’ombre, aujourd’hui nous assistons à un réel intérêt pour une analyse des phénomènes migratoires centrée sur le genre. L’analyse du genre n’est plus limitée à la sphère privée (vie de famille, ménage…) mais est utilisée dans toutes les facettes du processus migratoire et à différents niveaux (Donato et al., 2006). Ce type d’analyse permet de saisir les différentes façons dont les rôles, les identités et les relations de genre, chacun ancré dans des contextes particuliers, affectent les processus, les dynamiques et les tendances migratoires (Timmerman et al., 2018).
Malgré l’intérêt académique pour le cas des femmes migrantes, une tendance persiste : celle d’associer la figure de la personne migrante à celle d’un homme. Les migrant·e·s restent perçu·e·s comme formant un groupe homogène et les différences d’identité de genre, d’orientation sexuelle, d’origine, de classe sociale, ne sont pas prises en compte (Morokvasic, 2008). Alors qu’au niveau mondial les femmes migrantes sont en réalité plus nombreuses que les hommes (Asis, 2005 ; Morokvasic, 2015). Cependant, elles ont peu la parole et sont absentes des discours politiques et médiatiques (Schoenmaeckers & Rousset, 2018). Il est également important de noter qu’il y a de grandes disparités au niveau de la répartition homme-femme selon les régions du monde (Morokvasic, 2011). Cette hétérogénéité est bien représentée en Belgique, où les chiffres du CGRA vont à l’encontre de la dominance mondiale. En effet, en 2022, 70,6 % des demandeur·se·s de protection internationale étaient des hommes, contre 29,4 % de femmes.
C’est dans ce contexte d’invisibilisation persistante de l’expérience des femmes en termes de migration que j’ai réalisé ma recherche dans le cadre de mon mémoire. Je m’y suis intéressée aux vécus du temps d’attente des résident·e·s dans l’un des centres d’accueil collectif prévus pour les demandeur·euse·s de protection internationale tout le long de leur procédure de régularisation. J’aurai l’occasion d’en évoquer quelques observations au cours de cette analyse.
Politique d’asile belge
Confrontées à la persécution, la majorité des personnes qui fuient se réfugient dans un pays voisin ou se déplacent à l’intérieur de leur propre pays (migration interne). Une minorité de personnes cherchent et parviennent à venir en Europe (Schoenmaeckers & Rousset, 2018). En Belgique, – comme dans tous les autres pays européens – tout·e étranger·ère qui arrive sur le territoire « peut y demander l’asile et solliciter la protection internationale des autorités belges » comme le prévoit la loi du 15 décembre 1980. Le·La requérant·e devra parcourir les différentes étapes de la procédure de protection internationale. Durant celles-ci, l’État belge vérifie si le·la demandeur·deuse de protection internationale (DPI), aussi appelé demandeur d’asile dans le passé1, correspond aux critères définis par la Convention de Genève relative au statut des réfugiés datant de 19512. Ces critères visent à protéger toute personne qui fuit son pays parce qu’elle craint « avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ». Cette vérification sera réalisée par l’Office des Étrangers (OE) dans un premier temps, puis par l’administration belge du Commissariat Général pour Réfugiés et Apatrides (CGRA), dans un second temps. En plus de pouvoir octroyer le statut de réfugie.é, le CGRA peut aussi accorder le statut de protection subsidiaire. Il vérifiera alors si la personne répond aux exigences spécifiques liées à ce statut. La protection subsidiaire sera accordée à toute personne qui ne peut pas être reconnue réfugiée selon les cinq critères définis par la Convention de Genève, mais qui encourt un risque réel d’atteintes graves à sa vie en cas de retour, notamment en raison d’une violence aveugle liée à un conflit armé. Le système belge de traitement des demandes m’est apparu comme très lent au même titre que ceux·celles qui vivent la procédure de demande de protection internationale. En effet, comme j’ai pu le constater durant mon terrain ethnographique, il y a des personnes qui attendent plusieurs années avant d’accéder ne serait-ce qu’au premier entretien au CGRA. A titre d’exemple, j’ai rencontré un couple – qui s’est construit en Belgique au centre d’accueil – qui a reçu une réponse positive pour les deux partenaires au bout de 10 ans d’attente. Durant cette décennie ils ont conçu quatre enfants, lesquels n’auront jamais connu jusque-là une autre réalité que celle de la vie dans une centre d’accueil collectif… Ce cas n’est malheureusement pas isolé.
Expériences de persécutions spécifiques
L’invisibilisation des femmes dans le phénomène migratoire est d’autant plus regrettable qu’il existe, dans les faits, une vulnérabilité spécifique des femmes dans leurs processus migratoires due à de nombreux facteurs. Dans cette perspective, il est important comme le montrent Bilge et Denis (2010), sociologues, d’adopter une approche intersectionnelle pour étudier la situation des femmes dans la migration. L’intersectionnalité est un concept développé par Crenshaw (2005) à la fin des années 80. Il permet de mettre en lumière la manière dont différentes formes de discriminations interagissent et se chevauchent, créant donc des expériences uniques d’oppression. Dans le cas présent par exemple, les femmes peuvent être victimes de multiples dynamiques de pouvoir, par exemple la race, la classe sociale, la sexualité, l’âge, la nationalité, la religion, la caste, … L’approche intersectionnelle permet de reconnaître que les identités multiples d’une migrante peuvent se combiner et influencent conjointement alors son expérience migratoire, au lieu de traiter chaque aspect de manière individuelle.
Dans leur pays d’origine
Comme toutes les personnes qui quittent leur pays d’origine pour des raisons économiques, politiques ou autres, les femmes sont exposées au cours de leur migration aux différents risques inhérents à l’exil. Cependant, l’inégalité de genre face à la décision migratoire commence dès le pays d’origine. Alors que les relations de genre peuvent être des « push factors » (facteurs d’incitation), elles peuvent également constituer un frein important à la mobilité des femmes (Mahieu et al., 2010). La position des femmes dans le pays d’origine influence non seulement leur possibilité de migrer de façon autonome, mais également leurs accès aux moyens nécessaires en termes de réseaux ou de ressources économiques par exemple (Boyd & Grieco, 2003). Les relations de genre dans le pays d’origine et les attentes spécifiques à propos des comportements des hommes et des femmes influencent la prise de décision migratoire. En effet, les motivations des femmes ne sont pas nécessairement les mêmes que celles des hommes, puisque les violences subies par les femmes, déjà dans leur pays d’origine, sont dans la plupart des cas genrées c’est-à-dire qui repose sur les distinctions relatives aux genres. Par exemple, ne pas se conformer aux normes culturelles, religieuses, vestimentaires aura des conséquences plus importantes pour les femmes (Timmerman et al., 2018). Un autre aspect de cette différence genrée est que les femmes ont généralement la charge principale des enfants. Cela engendre donc une restriction matérielle et financière pour organiser leur départ (Freedman, 2008). Il peut être difficile pour une femme de partir – seule ou avec ses enfants – car elle est tenue responsable de l’éducation de ses enfants.
Sur les routes migratoires
Ensuite, comme l’explique Pierrick Devidal (2005), pendant le voyage, les risques d’être confrontées à des situations de dangers et de violences, telles que le viol, la prostitution, l’enlèvement, le trafic d’êtres humains ou d’organes, sont multipliés en raison de leur sexe et de leur genre. Tout au long de leur parcours, elles seront placées en situation de dépendance vis-à-vis de personnes dont la grande majorité sera des hommes (mari, policiers, passeurs, gardes-frontières, militaires, douaniers, transporteurs…), exerçant sur elles un pouvoir, et donc susceptibles d’en abuser. Afin de se sentir plus en sécurité, il arrive fréquemment que les femmes décident de se regrouper par pays d’origine ou de se mettre sous la protection d’un homme (Schoenmaeckers & Rousset, 2018). La fermeture des frontières européennes a de lourdes conséquences sur la sécurité des personnes migrantes qui cherchent à obtenir un statut de protection internationale de la part d’un pays membre de l’Union Européenne. Plutôt que de décourager les migrant·e·s n’ayant pas la possibilité d’arriver de façon légale en Europe, ces mesures (gardes-frontières, barrières, technologies de surveillance, accords européens et bilatéraux avec des pays tiers…) les forcent à chercher de nouveaux chemins, encore plus dangereux (Gioe, 2018).
Dès l’arrivée dans le pays d’accueil…
… le traitement de la demande
Une fois arrivées en Belgique, contrairement à ce que l’on pourrait croire, les violences de genre ne prennent pas fin. Ce, notamment à cause des lois et des politiques qui sont appliquées. En effet, bien qu’officiellement les politiques de migration soient neutres, Jane Freedman (2008), sociologue spécialisée dans le domaine des migrations et des violences de genre, pointe qu’elles sont tout de même basées sur des présupposés liés au genre et ont des effets différents pour un·e DPI homme ou femme. À titre illustratif, l’absence de reconnaissance des violences spécifiques de genre dans la procédure d’obtention d’un statut de protection internationale perpétue les violences vécues par les femmes dans le pays d’accueil. Les femmes sont victimes des Conventions et des lois qui ne reconnaissent pas les violences spécifiques qu’elles subissent comme légitimes pour pouvoir accéder à une protection. L’absence de reconnaissance, voire la délégitimation, des persécutions spécifiques à l’encontre des femmes s’expliquent par plusieurs éléments.
Premièrement, comme l’explique Freedman (2008), les activités des femmes ne sont souvent pas reconnues comme étant des « activités politiques », au même titre que celles des hommes. Leur engagement politique est fréquemment plus indirect comme, par exemple, lorsqu’elles nourrissent, soignent ou abritent des personnes engagées politiquement, souvent des hommes. Cela a pour conséquence qu’elles entrent difficilement dans la définition classique « d’activité politique ». De ce fait, selon le cadre admis par la Convention de Genève (1951), elles ne peuvent pas prétendre à la protection pour danger en cas d’activité politique « indirecte » car elles ne se classent pas dans cette catégorie en théorie, bien que cela soit le cas en pratique.
Deuxièmement, les persécutions dont les femmes sont victimes sont considérées comme illégitimes pour prétendre à une protection parce qu’elles se déroulent généralement dans la sphère privée. Elles sont, le plus souvent, perpétrées par des acteurs non étatiques. Cependant, la sphère privée est à l’abri de la surveillance de l’État (Dividal, 2005). Par exemple, le cas des violences conjugales n’est perçu que dans très peu de pays comme un motif légitime de demande de protection internationale. En outre, parfois, les persécutions peuvent être considérées comme faisant partie de la culture propre du pays d’origine des femmes sollicitant une protection. Cela peut être le cas des mariages forcés ou de l’excision comme le montre cet exemple de la Grande-Bretagne. En 20053, la cours d’appel avait refusé l’octroi du statut de réfugiée à une femme du Sierra Leone menacée d’excision si elle retournait dans son pays en prétextant que l’excision faisait partie de la coutume du pays et que la majorité de la population locale l’acceptait comme une pratique normale (Freedman, 2008).
De plus, alors qu’en droit international, les États ont l’obligation de garantir une protection efficace et effective sans discrimination pour tous·tes les DPI, certaines mesures européennes actuelles discriminent tout de même les femmes. Par exemple, la Convention de Dublin (1990) est discriminante pour les personnes voulant introduire une demande concernant des persécutions liées au genre. En effet, cette Convention requiert que la demande de protection internationale ne puisse être effectuée que dans le premier pays de l’UE par lequel le·a migrant·e arrive, le pays d’entrée. Cependant, il existe des différences significatives dans la façon dont les États de l’UE traitent les demandes de protections internationales motivées par des persécutions liées au genre. Ces différences s’expliquent en fonction de la sensibilité partagée au sein du pays par rapport à ces questions.
Par ailleurs, l’Europe a établi une liste de « pays sûrs », c’est-à-dire une liste de pays considérés comme sans danger pour y vivre. A titre d’exemple, en Belgique en 2023, les pays suivants sont actuellement considérés comme des pays d’origine sûrs : l’Albanie, la Bosnie-Herzégovine, la République de Macédoine du Nord, le Kosovo, le Monténégro, la Serbie et l’Inde. Les demandes de protection internationale de personnes issues de ces pays sont donc généralement rejetées d’office. Cependant, l’attribution du caractère « sûr » à un pays ne prend pas en compte la situation des droits fondamentaux des femmes dans celui-ci. Cela renforce la problématique concernant les persécutions spécifiques faites aux femmes qui se déroulent généralement dans la sphère privée (Freedman, 2008). En effet, certains pays sont désignés comme « sûrs » en raison de l’absence de persécutions publiques formellement organisées ou soutenues par l’État. Néanmoins, ces endroits peuvent connaître de fréquentes persécutions « privées » à l’encontre des femmes, sans que celles-ci puissent bénéficier d’une protection étatique contre ces actes. En outre, il est important de noter que la liste des pays sûrs n’est pas la même dans chaque État européen ce qui est un argument supplémentaire pour remettre en doute la pertinence de cette pratique : si les pays dits « sûrs » l’étaient réellement, pourquoi tous les pays européens ne peuvent pas se mettre d’accord sur une liste commune ?
C’est pour toutes ces raisons explique Freedman (2008) que les Conventions et législations internationales sur les réfugiés sont critiquées et remises en cause. Le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés réclame que le genre soit intégré comme motif de persécution dans la Convention de Genève relative au statut de réfugié·e. Pour l’instant, à ce jour, le genre reste absent des motifs de persécution possible selon la définition donnée par cette Convention. Pourtant, il est largement démontré que les persécutions liées au genre ont aussi des imbrications politiques, religieuses… figurant quant à eux dans les motifs présents dans la Convention.
Le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés a d’ailleurs publié, en 2008, ses « principes directeurs liés au genre » qui met en avant l’importance de la prise en compte du genre en matière de protection internationale. Le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés y définit le genre comme « les relations entre les femmes et les hommes basées sur des identités, des statuts, des rôles et des responsabilités qui sont définis ou construits socialement ou culturellement, et qui sont attribués aux hommes et aux femmes ». Ce texte à portée internationale, est souvent utilisé lors de recours pour faire valoir la dimension genrée spécifique des situations des demandeur·euse·s de protection internationale. Par ailleurs, existe aussi la Convention d’Istanbul, entrée en vigueur en 2014, qui vise à prévenir la violence envers les femmes, y compris la violence domestique, la violence sexuelle, la mutilation génitale féminine, le mariage forcé et le harcèlement. Ce texte représente également un outil utilisé par les avocat·e·s au cours des procédures.
…au sein des structures d’accueil
Par ailleurs, conformément à la loi du 12 janvier 2007 sur « l’accueil des demandeur·se·s d’asile et d’autres catégories d’étrangers », pendant le traitement de sa procédure, le·la demandeur·se·s de protection internationale dispose légalement d’un droit à « l’accueil ». En réalité, la loi du 12 janvier 2007 transpose en droit belge les directives 2003/9/CE et 2013/33/EU de l’Union européenne. Ces directives fixent des normes minimales sur les conditions d’accueil des demandeur·se·s de protection internationale et permet d’harmoniser celles-ci dans les différents États membres. L’État belge s’est donc engagé à assumer l’accueil des personnes en demande de protection internationale, leur assurant de mener une vie conforme à la dignité humaine. L’accueil comprend, non seulement, une aide matérielle (hébergement, nourriture, vêtements, allocation journalière…) mais également, un accompagnement juridique, social, médical et psychologique. Cette aide est assurée principalement au sein de structures d’accueil communautaires gérées par l’instance fédérale Fedasil ou par ses partenaires. Cet appui n’est pas obligatoire ni systématique mais est demandé dans la grande majorité des cas.
Cependant, depuis l’été 2008, dans les faits, ce droit n’est plus assuré pour tous·tes en raison d’une saturation du réseau d’accueil (Carion et al., 2010). La crise actuelle, en termes d’accueil (Calabrese et al., 2022), est liée, d’une part, à une augmentation des demandes et d’autre part, à l’absence de volonté politique à favoriser un accueil qualitatif aux personnes demandeuses de protection internationale. Cette crise complique donc l’obtention de ce droit entre autres à l’hébergement. Le centre d’arrivée du Petit Château à Bruxelles, sélectionne à qui les places sont attribuées, en fonction de critères de vulnérabilité. Les personnes plus fragiles, comme les personnes malades, psychologiquement instables, traumatisées, ou blessées, sont prioritaires, ainsi que les femmes, les enfants et les familles. Les hommes isolés sont donc en fin de liste.
Lors de leur arrivée sur le territoire belge, et spécialement dans des centres d’accueil, les demandeuses ont, comme l’ensemble des personnes en cours de procédure pour l’obtention du statut de réfugié, droit à un suivi médical et psychologique. Cela peut permettre à ces dernières d’être prises en charge pour les violences spécifiques à leur condition féminine. Par exemple, il existe un seul centre spécialisé dans l’accueil des victimes de violences de genre en Belgique. Ce centre accueille les demandeur·deuse·s de protection internationale les plus vulnérables ayant subi des violences de genre que ce soit dans leur pays d’origine, sur le parcours d’exil ou en Belgique : exploitation sexuelle, mariage forcé, excision, restrictions liées à leur statut de femme…. Y sont assurées d’un suivi individuel ainsi que des ateliers collectifs et des formations renforçant le bien-être, le sentiment de sécurité ainsi que la connaissance des femmes en matière de santé et de droits fondamentaux. Cependant, dans la plupart des centres de Belgique, aucun suivi similaire n’est mis en place. Les personnes ayant subi des violences de genre ne sont donc généralement pas suffisamment suivies et leur arrivée en Belgique ne signifie pas le bout de leur peine…
Focus sur le cas des mères au sein des centres d’accueil collectif
Les femmes migrantes ont une sorte de privilège car elles sont considérées comme prioritaires concernant les places au sein des structures d’accueil. Si l’État belge semble privilégier le statut de femme et de mères concernant le droit à l’accueil des demandeur·se·s de protection internationale, qu’en est-il réellement au sein de la vie quotidienne du centre ?
C’est dans ce contexte que j’ai voulu m’intéresser au cas des femmes migrantes dans leur dernière étape de leur parcours migratoire : l’attente en vue de l’obtention de leur statut de réfugiée dans le pays dans lequel elles ont fait la demande. Pour ce faire, j’ai réalisé un travail de terrain pendant 3 mois intensifs (précédé de 2 mois d’observations hebdomadaire préliminaire) au sein de l’un des centres d’accueil collectif pour demandeur·se·s de protection internationale dans la province de Liège. J’ai intégré le centre d’accueil en tant que stagiaire dans l’équipe de la polyvalence. Dans le cadre de ce terrain ethnographique, j’ai appliqué la méthodologie de l’observation participante (Olivier de Sardan, 1995). J’ai essayé, le plus possible, de partager du temps avec les résident·e·s tout en accomplissant les tâches qui m’étaient assignées par l’équipe et la direction. Le but de ma recherche était d’être en interaction maximale avec les résident·e·s pour pouvoir mieux appréhender leurs vécus du « temps d’attente » (Kobelinsky, 2010) ainsi que les dimensions de pouvoir (tant entre résident·e·s-collaborateur·rice·s qu’entre résident·e·s entre eux·elles) qui se cachaient au sein des interactions dans l’institution. En raison de mes intérêts personnels, j’ai construit davantage de relations privilégiées avec les mères habitant au centre. J’ai pu m’intégrer parmi elles, dans une certaine mesure, au fur et à mesure des moments partagés avec elles, ensemble. De manière plus pointue encore, mon travail de recherche s’est donc principalement focalisé sur le vécu de ces femmes au sujet de leur maternité au sein du centre et surtout comment cette maternité pouvait influencer leur temps d’attente ?
En toutes circonstances, l’arrivée d’un enfant est source de changement majeur dans la vie d’une femme. Dans un contexte migratoire, elle constitue tout à la fois un défi susceptible de fragiliser la mère, mais également potentiellement pour elle, une source de résilience exceptionnelle. Grâce à mon travail de terrain, j’ai pu constater ces deux dimensions contradictoires simultanément en jeu dans le contexte de la maternité (Meert, 2023).
D’abord, les enfants et nouveau-né·e·s, constituent pour les mères, une raison d’espérer et de garder la tête hors de l’eau. Les jeunes mamans expliquent qu’elles gardent le courage de subir le temps d’attente affreusement long ainsi que les injonctions propres la procédure (rendez-vous, règles de vie commune au sein du centre, interrogatoires qui leur font revivre des traumatismes qu’elles auraient préféré oublier, etc.) dans l’espoir qu’une obtention de statut permette à leur enfant d’avoir une vie meilleure par rapport à la leur.
Ensuite, les mères que j’ai pu rencontrer sont unanimes. Leur bébé les occupe, leur apporte de la joie, leur permet de penser à autre chose que leur condition de vie difficile au sein du centre et de ne pas tomber dans un ennui trop important (Kobelinsky, 2010). En effet, leurs journées sont rythmées par les besoins de leur(s) enfant(s) (tétée, lavage, changement de couches, conduire et rechercher l’enfant à l’école, devoirs scolaires…). Ces derniers leur permettent d’avoir des repères temporels et des impératifs à remplir qui permettent de ne pas tomber dans « l’indissociation du temps » (Cunha, 1997). Par exemple, pour des mères ayant des enfants scolarisés, leur temporalité sera liée à l’éducation et à la scolarité de leur(s) enfant(s) : se lever pour préparer à manger, conduire l’enfant à l’école (lorsqu’elle n’est pas trop loin) ou amener l’enfant à la navette scolaire prévue par le centre, attendre le retour de l’enfant, l’aider à faire ses devoirs si elle en a les capacités…
Cependant, j’ai pu observer que cet avantage d’occuper les mères à plein temps peut aussi se retourner contre elles à différents moments. Par exemple, lorsqu’elles veulent construire un avenir professionnel grâce à des formations, des études supérieures ou des cours de langues. Ou lorsqu’elles veulent pouvoir aller travailler pour obtenir davantage d’autonomie financière par rapport au centre. Ou encore lorsqu’elles veulent participer à des activités extérieures gratuites proposées par les collaborateur·rice·s du centre dans le but de se divertir. Pour pouvoir accéder à ces différentes ressources et opportunités (formation, cours de langue, travail communautaire, activités) les mères doivent être en mesure de faire garder leur enfant. Le centre dans lequel j’ai réalisé mon terrain ethnographique ne disposait d’aucun dispositif4 tel qu’une crèche ou une garderie à cet effet. De ce fait, les mères célibataires doivent s’appuyer exclusivement sur la solidarité intra-institution, inter–résidentes. J’ai pu observer des pratiques d’entraide où les mères s’occupaient à tour de rôle des enfants d’une (ou de plusieurs) chambre(s) pour pouvoir se dégager du temps individuel, du temps « pour soi ». Cependant, cette absence de soutien à la maternité organisé collectivement cantonnait la majorité des mères à des tâches strictement éducatives et de soins à leur(s) enfant(s).
De plus, j’ai pu observer qu’en étant enceinte ou en ayant des enfants, les femmes accèdent au statut de mère qui leur confère dans les faits au centre certains « privilèges », c’est-à-dire des exceptions aux règles, et ce, dès l’annonce de la grossesse. Comme par exemple, enregistrer leurs badges en dehors des heures prévues, obtenir une rencontre avec leur assistant·e social·e dans des horaires décalés, avoir la priorité sur des contrats de travail communautaires, etc. Ce type de comportement s’apparente à des pratiques de discrimination positive. En lien avec les travaux de Virole-Zajde (2016), la maternité peut devenir pour ces femmes un moyen d’être davantage reconnues par l’équipe de collaborateur·rice·s du centre. En effet, lorsqu’une femme arrive seule avec un enfant ou qu’une femme tombe enceinte au centre, l’attention est automatiquement portée sur elle, elle se démarque de la masse des autres résident·e·s. Ces privilèges peuvent s’observer dans les « small talk » (papotages) qui se déroulent dans les couloirs : « on demande « ah comment ça va ? », on s’attarde beaucoup plus sur comment la personne se sent quand elle a un bébé qu’une femme seule » (entretien, collaboratrice du centre d’accueil spécialisé dans l’accueil des femmes victimes de violences de genre, 12/05/2023). Cependant, cet intérêt particulier est majoritairement orienté vers l’enfant et la vie familiale plutôt que vers l’état des mères de manière individuelle : « on se préoccupe pas beaucoup de la personne derrière le bébé » (entretien, collaboratrice du centre d’accueil spécialisé dans l’accueil des femmes victimes de violences de genre, 12/05/2023). Cela peut réduire la femme uniquement à son statut de mère.
Ces éléments mettent en avant à quel point la présence d’un enfant – malgré l’ensemble des points positifs que cela peut apporter – peut empêcher la personne responsable, souvent la mère dans le cas présent, de se consacrer à d’autres activités que l’éducation des enfants. Cela peut entrainer la mère dans une spirale d’isolement où elle reste majoritairement au centre pour s’occuper de son enfant, ne participe pas à des formations qui pourraient lui permettre de trouver du travail, ne participe pas à des activités extérieures qui lui permettraient de se sociabiliser… Cela ne permet pas aux mères d’apprivoiser la vie sociale belge et à terme complique potentiellement leur intégration dans la société d’accueil. Finalement, l’ambivalence de ce rôle de mère et toutes les obligations que cela implique ajoute sur les épaules de ces mamans un poids supplémentaire. Alors que ces femmes migrantes ont souvent rencontré énormément de difficultés tout au long de leur parcours migratoire, du pays d’origine jusqu’au pays d’accueil, elles continuent de subir des discriminations en Belgique. Les structures d’accueil devraient normalement être un endroit où il leur est permis de souffler un peu. Pourtant, dès leur arrivée dans les centres d’accueil, un autre combat commence : celui de vivre sa maternité au sein de telle structure. La maternité ajoute à la condition féminine, déjà précaire, une fragilité supplémentaire qui rend la vie de ces femmes plus difficile à gérer. La souffrance ne s’arrêtera pas pour elles, même dans le meilleur des cas c’est-à-dire si elles obtiennent leur statut de protection internationale. En effet, en sortant du centre elles rejoindront probablement le grand groupe de mères en Belgique qui rencontrent des difficultés au quotidien telle qu’être sans ressource financière, avec plusieurs enfants, ne pas avoir accès à des soins, avec toutes les conséquences que cela implique encore d’avantage si elles fondent une famille monoparentale…
Conclusion
Au vu de tout ce qui a été énoncé précédemment, il semble important de revenir sur quelques points centraux. D’abord, il est nécessaire dans une perspective intersectionnnelle de reconnaitre l’accumulation des diverses formes de persécutions et de dominations vécues au quotidien, non seulement par les femmes migrantes, mais également par les femmes en général. En effet, l’ambivalence inhérente à la maternité touche toutes les mères en situation de précarité, qu’elles soient migrantes ou non.
En outre, comme le plaide notamment Freedman (2008), dans le cadre des demandes de protection internationale, les dispositifs légaux devraient davantage prendre en compte la sphère privée afin de favoriser la reconnaissance des violences « privées » vécues par les femmes et leur rôle actif dans la sphère politique.
Enfin, il serait également bénéfique pour les femmes migrantes de modifier la Convention de Dublin (1990) afin qu’elles ne soient pas soumises à l’obligation de devoir introduire leur demande dans le pays où elles arrivent, mais bien dans le pays de leur choix qui leur semble le plus susceptible d’être réceptif aux motifs de leurs persécutions spécifiques. Une alternative serait d’harmoniser l’attitude des pays de l’Union Européenne à cet égard. Cette alternative bien que séduisante, me parait cependant moins réaliste car chaque pays a sa propre histoire et a construit ses propres sensibilités à cet égard en fonction de sa culture.
De plus, la Convention de Genève devrait elle aussi, être retravaillée à la lumière du travail réalisé par le Haut-Commissariat des Nations Unies dans ses « principes directeurs liés au genre ». L’inclusion du genre dans les motifs présents dans la Convention de Genève (race, religion, nationalité, appartenance à un certain groupe social, opinions politiques) parait indispensable pour un traitement plus juste des demandes. Devidal (2005), conseiller politique au sein du Comité international de la Croix-Rouge, soutient cette idée et souligne que la Convention de Genève (1951) a été construite sur la base d’expériences et de modèles masculins. Ce texte est donc inadapté à la situation de la plupart des femmes. Ce qui, finalement, les discrimine. Il recommande donc que la protection des femmes soit un sujet auquel on accorde plus d’attention dans les textes légaux fondamentaux (Devial, 2005).
Illustration

Image générée par DALL-E
Notes :
¹ Les directives européennes 2013/32/UE et 2013/33/UE ont changé la terminologie en changeant le terme demandeur d’asile en demandeur de protection internationale. Ces directives ont été transposées en droit belge par les lois du 21 novembre 2017 et du 17 décembre 2017. Cependant, tout est entré en vigueur le 22 mars 2018. La raison pour laquelle ce changement de terminologie a été effectué est une volonté que le terme « demandeur de protection internationale » reprenne le statut de réfugié mais aussi celui de protection subsidiaire. Davantage d’explications sont disponibles sur le site du CGRA : https://www.cgra.be/fr/actualite/transposition-de-la-directive-procedure-dasile?fbclid=IwAR1RZdRPAq0jBkRfNbIlMfkzYNee-Wal1Jv_ed0CbRSeUxVBV-x5u39YYAk
² L’entièreté du texte est disponible sur le site du CGRA : https://www.cgra.be/sites/default/files/content/download/files/convention_de_geneve.pdf
3 Après la publication de l’article référencé, des pratiques légales ont été modifiées, notamment avec l’introduction de la « protection subsidiaire ».
4 A noter que le projet de mettre en place une crèche était dans les objectifs de l’année du centre. Cela démontre que l’institution se rendait donc bien compte que cette situation n’était pas confortable pour les parents célibataires
Bibliographie
Asis, M.M.B. (2005). International migration and the millennium development goals. International migration and prospects for gender equality. United Nations Population Meeting (UNFPA), 113 – 123.
Bilge, S., & Denis, A. (2010). Introduction: Women, intersectionality and diasporas. Journal of intercultural studies, 31(1), 1-8.
Boyd, M., & Grieco, E. (2003). Women and migration: Incorporating gender into international migration theory. Migration information source, 1(35), 28.
Calabrese, L., Gaboriaux, C., & Veniard, M. (2022). L’accueil en crise: pratiques discursives et actions politiques. Mots. Les langages du politique, (129), 9-21.
Carion, F. et al. (2010). Les visages de la crise de l’accueil. La crise de l’accueil vue par les demandeurs d’asile, les acteurs de terrain, les citoyens et les responsables politiques. CIRÉ, Bruxelles.
Cunha, M. I. (1997). Le temps suspendu. Rythmes et durées dans une prison portugaise. Association Terrain. 29, 59-68.
Crenshaw, Kimberlé Williams, « Cartographies des marges : intersectionnalité, politique de l’identité et violences contre les femmes de couleur », Cahiers du Genre, vol. 39, n° 2, 2005 (1991), p. 51-82.
Devidal, P. (2005). Pour un système de protection active des femmes réfugiées. Recueil Alexandries.
Freedman, J. (2008). Genre et migration forcée: les femmes exilées en Europe. Les cahiers du CEDREF. Centre d’enseignement, d’études et de recherches pour les études féministes, (16), 169-188.
Gioe, S. (2018). Frontières, papiers, humains! Banalité du mal et migration. Presses universitaires de Liège.
Kobelinsky, C. (2010). L’accueil des demandeurs d’asile. Une ethnographie de l’attente. Éditions du Cygne.
Mahieu, R., Timmerman, C., & Vanheule, D. (2010). La dimension de genre dans la politique belge et européenne d’asile et de migration. Institut pour l’égalité des hommes et des femmes de Belgique
Meert, E. (2023). Vivre (dans) l’attente. Une ethnographie d’un centre d’accueil collectif pour demandeur·se·s de protection internationale à Liège, avec un focus sur l’expérience des femmes. Université de Liège, Liège, Belgique.
Morokvasic, M. (2008). Femmes et genre dans l’étude des migrations: un regard rétrospectif. Les cahiers du CEDREF, (16), 33-56.
Morokvasic, M. (2011). L’(in) visibilité continue. Cahiers du genre, 2(51), 25-47.
Morokvasic, M. (2015). La visibilité des femmes migrantes dans l’espace public. Hommes & migrations, 1311, 7-13.
Olivier de Sardan, J. P. (1995). La politique du terrain. Sur la production des données en anthropologie. Enquête, (1), 71-109.
Rousset, C., & Schoenmaeckers, D. (2018). Genre et migration. Le monde selon les femmes
Virole-Zajde, L. (2016). Devenir mère, Devenir sujet? Parcours de femmes enceintes sans-papiers en France. Genre, sexualité & société, (16), 1-15.